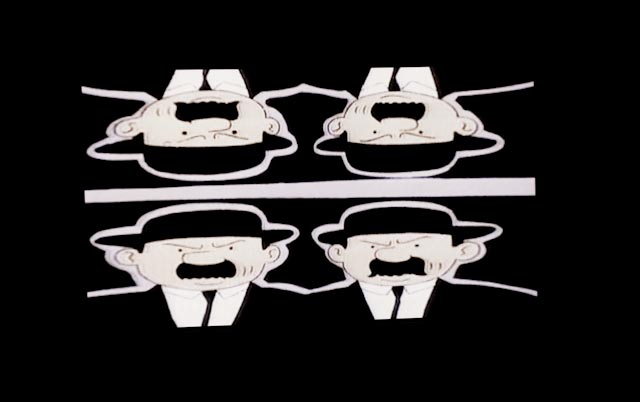Et qu’en pense Madame Laculture ?
L’art se popularise. Ses moyens d’expression se multiplient. Les pratiques, les courants artistiques se diversifient. Tout semble permis. Qui s’en plaindrait ? Les critères d’évaluation esthétique en matière de Beaux-Arts ne devenaient-ils pas obsolètes au regard de nos ambitions démocratiques ? Le Beau, l’idéal de beauté, pierre angulaire de nos jugements artistiques, n’était-il pas soumis aux valeurs sociales, morales, politiques et religieuses de l’élite ? Peindre le beau c’était asservir son esthétisme aux valeurs dominantes. Représenter le monde c’était rendre visible le système de valeurs des puissants. S’en détacher vouait l’artiste aux gémonies.
Quand Manet décide de peindre non plus le beau mais le vrai son Olympia (1863) devient une femme vénale, – « un modèle obscène et chétif, une odalisque au ventre jaune », hurlent les critiques. Lorsque Courbet présente L’Origine du monde (1866), une femme aux cuisses ouvertes, sexe béant, son tableau est immédiatement mis à l’index, en raison de son obscénité qui transgresse les conventions sociales – les mœurs – de la classe bourgeoise. Malgré sa représentation figurative et réaliste d’une très grande technicité picturale on lui dénie sa qualité d’œuvre d’art. Les normes d’évaluation morales l’emportent sur les référents esthétiques.
Ces critères esthétiques, Duchamp va totalement les disqualifier en élevant au rang d’œuvres d’art un objet industriel, un ready-made, un objet tout fait, d’une triviale et confondante banalité : une pissotière, un urinoir en porcelaine, baptisé Fontaine (1917). « Que Duchamp ait fabriqué la Fontainede ses propres mains ou non est sans importance. Il l’a CHOISIE. Il a pris un objet de sa vie quotidienne, l’a mis en situation au point de faire oublier sa fonction et sa signification utilitaire sous un nouveau titre et un nouveau point de vue – et a créé une pensée nouvelle de cet objet » peut-on lire dans l’éditorial non signé d’une revue artistique.
Désormais la création est moins dans l’objet regardé que dans le regard porté par l’artiste. Les critères d’appréciation esthétiques (beauté, harmonie, ressemblance, représentation fidèle à la nature, technique, métier) reculent devant la totale liberté de création de l’artiste. Mais si les artistes peuvent s’exprimer sans réserve, critiques et spectateurs sont invités à la plus grande réserve. Comment pourraient-il juger d’une œuvre en faisant fi de ces critères esthétiques qui font leur jugement ?
L’art moderne ne se construit-il pas à rebours de tous ces canons académiques qui définissaient la notion d’œuvre d’art ? Quant à L’art contemporain, il va bien au-delà de la simple dépréciation des critères esthétiques puisqu’il entend s’exprimer non plus en réaction au système institutionnalisé des Beaux-arts mais en dehors de lui. Donnant à tous (acteurs comme spectateurs) la liberté de penser, de voir, de ressentir à distance de toutes assignations esthétiques, de toutes considérations morales, religieuses, sociales, politiques…
L’art contemporain devenant sans définition, ses déclinaisons sont sans limite : happenings, installations, body art, performances, vidéo, photographie, design, art numérique, communication visuelle… On ne parle plus d’œuvre mais d’expressions plastiques au concept aussi ductile que l’élastique… avec pour conséquence que s’il se démocratise dans sa pratique (pas nécessaire de maîtriser une technique, un savoir-faire) il « s’élitise » dans sa réception sociale, rejeté par la grande majorité de ceux qui le reçoivent (public) et le perçoivent toujours à l’aune de critères traditionnels.
Mais l’art contemporain est autre, tout autre… en partie seulement. Car sans partager avec les artistes cette communauté de desseins (se vouer à l’expression du beau) ses praticiens, les plasticiens (qui abordent tous les champs du visible sans rechercher forcément le beau) aspirent au même destin : être reconnu, sortir de l’anonymat. Aussi bien pour leur art – ou non art – que pour faire valoir les droits pécuniaires attachés à sa reconnaissance; consécration vitale pour qui veut survivre dans une économie de marché où chacun – du concepteur, artiste, plasticien, jusqu’au collectionneur – entend protéger au plus près ses intérêts.
Mais sur quelle base les défendre quand disparaissent tous les critères auxquels on se référait pour juger de la qualité d’une œuvre ? Question d’autant plus difficile que si l’art contemporain s’exprime en dehors de toutes normes préétablies, son marché a besoin d’identifier, « d’organiser » la qualité pour la survie économique de ses acteurs. La connaissance de la qualité (ou de la non qualité comme qualité) est un préalable indispensable au bon fonctionnement de tout marché.
Doit-on apprécier l’originalité de la démarche conceptuelle du plasticien ? Son potentiel provocateur, médiatique, spéculatif, subversif quand bien même cette subversion serait subventionnée par une institution ? Doit-on prendre en compte la notoriété du sujet représenté ? Celle de l’artiste ? De ses collectionneurs privés, publics ? Le prestige du lieu où il expose (Le Louvre par exemple) ? Sa file d’attente ? Son prix exorbitant qui fait toute la valeur de la pièce (même si la faiblesse de la pièce interpelle sur la valeur de l’argent chez celui qui dépense sans compter) (1).
Autant de critères qui peuvent être interprétés comme des faisceaux d’indices de qualité ; autant de stratégies adaptées selon les sphères visées, le plus souvent celles qui ont de l’argent, de l’entregent et du temps libre pour se distraire et se cultiver. Mais à la « bonne société » restreinte des siècles précédents succède depuis le milieu du 20e s. la société de masse aux attentes culturelles forcément des plus variées.
Hommes d’affaires, certains plasticiens n’hésitent pas à transformer leurs arts en puissances de distraction pour toucher le plus grand nombre. Parfois même avec la complicité des grandes institutions culturelles, soucieuses, face au désengagement financier de l’Etat, de transformer leurs espaces en train fantôme (2). L’observation cède le pas à l’événementiel ; l’amateur devient voyeur…
Mais qu’on le revendique ou le déteste, l’art contemporain épouse à merveille nos sociétés contemporaines. Il est au cœur de ces nouvelles industries culturelles qui comme toutes industries ne perdurent que dans la production de formes, d’idées, de biens consommables et consommés pour être produits à nouveau. Mais il peut être aussi ce trublion salvateur qui prend à rebours ces industries des loisirs toujours prêtes à annexer nos sens, à massicoter nos regards pour mieux étendre leurs emprises consuméristes.
Et qu’en pense Madame Laculture ?
Avec ses talons hauts, sa logorrhée, son « go-between » et ses cuisses garrottées par le nylon, elle est emblématique de cette innocence qu’obligent les connivences quand elles se tiennent à force d’indigences.
Madame Laculture n’est jamais aussi claire que dans la confusion ; moins bien sûr pour ce qu’elle dit que pour tout ce qui achoppe et lui échappe ; mais comment pourrait-on lui en tenir rigueur ? Une chaine n’est jamais aussi forte que son maillon le plus faible.
Madame Laculture, alias Rafële Arditti, nous prouve que le minimalisme d’une œuvre, ici une installation composée de brosses à dents prises dans les rets d’un filet, peut, au-delà de son utilité immédiate – brosser un portrait, un discours, une balle (pour lui donner cet effet particulier qui trompera l’adversaire) engendrer un art de la théâtralité.
Dans cette mise en circulation de mots et de formes où parasites et parasités sont condamnés à vivre – ou à mourir – ensemble, Mme Laculture illustre pleinement son art ; de l’art en mouvement qui ne tourne jamais en rond pour le cercle d’initiés (une poignée d’édiles d’ici ou d’ailleurs) qui en a établi les codes et a su imposer l’arbitraire de ses évaluations grâce à la légitimité prescriptrice de sa suffisance institutionnelle.Madame Laculture n’est pas une espèce en voie de disparition.
Tout ce qu’elle dit, toutes ces pépites qui donnent la pépie (la soif de ne plus savoir) ont été piochées par Rafaële dans des revues d’art contemporain. Une archéologie postmoderne des plus salvatrices car rien, non rien n’a été inventé.
On pourrait en rire et c’est d’ailleurs ce que l’on fait ; mais avec cette joie consommée qui ne relève pour une fois d’aucune industrie en dehors de celle plus artisanale de son interprète.
Merci Rafaële.
Philippe Pataud Célérier, mars 2013, préface au livre-cd de Rafaële Arditti, Madame Laculture, Éditions L’Attrape-Science, 2013
Notes :
(1) L’art contemporain de bâtir des fortunes avec du vent, Le Monde Diplomatique, août 2008. (2) Les milles et une astuces des musées pour se vendre, Le Monde Diplomatique, février 2007.
Le spectacle de Rafaële Arditti est actuellement joué (extrait) au Théâtre de la Vieille Grille.