Ôé Kenzaburo, l’écrivain de toutes les périphéries
Moi d’un Japon ambigu évoquait Oé dans son discours pour le prix Nobel de littérature en 1994. Il répondait à Moi, d’un beau Japon, prononcé quelques décennies plus tôt, en 1968, par Yasunari Kawabata (1899-1972), le premier écrivain japonais à recevoir ce prix.
Ôé Kenzaburo a six ans lorsque son pays entre en guerre contre les États-Unis. Il en a dix quand le Japon signe sa reddition inconditionnelle. Plus qu’une précision biographique, ces années marquent les premiers repères de son cheminement intellectuel. Cette guerre qui a façonné son enfance, on en trouve la trace immédiate dans son premier récit remarqué, Gibier d’élevage, couronné en 1958 par le prix Akutagawa, l’une des plus prestigieuses consécrations littéraires. En pleine seconde guerre mondiale, un avion américain s’écrase dans les montagnes. Le seul survivant est un soldat noir aussitôt emprisonné par les villageois. Cette « bête curieuse » tombée de nulle part va faire le bonheur des enfants avant d’être brutalement happé par la bêtise des adultes.
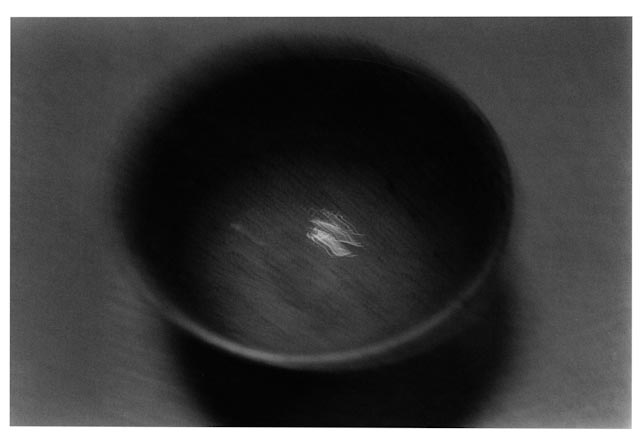
Là encore cette précision géographique n’est pas anecdotique. Né dans une « région périphérique d’une périphérie appelée Japon », Ôé se définit comme un écrivain de la périphérie ; une périphérie pensée d’abord comme le lieu échappant au centre et à son discours dominant. « La littérature doit toujours être écrite de la périphérie vers le centre » souligne Oé. Ce non conformisme, l’écrivain va le tirer de nombreuses sources. Étudiant en littérature française à l’université de Tokyo, formé par un spécialiste et traducteur de l’œuvre de Francois Rabelais, Ôé est profondément immergé dans la philosophie humaniste, de Rabelais jusqu’à Sartre (sur lequel il fit sa thèse). Cet humanisme livresque qu’il dévore avec un grand appétit de savoir va très vite se mettre au diapason de sa première épreuve et preuve d’humanité surgie par le biais d’un drame personnel. Ôé a 26 ans quand son épouse met au monde leur premier fils Hikari, handicapé mental.
« Comment une famille peut-elle vivre avec un enfant handicapé ? » Cette question qui l’ébranle alors même qu’il est en reportage à Hiroshima, il va y répondre en s’interrogeant sur le devenir des hibakusha, – les victimes de la bombe atomique-, le sens qu’on peut donner à leur vie détruite, le sens qu’on doit aussi donner à celles qui leur survivent. « Si nous sommes capables en imagination de nous figurer de façon juste ce tableau apocalyptique, alors devenir les compagnons des hibakusha n’est même plus une question de choix : c’est le seul moyen qu’il nous reste de vivre en êtres sains d’esprit. » (Notes d’Hiroshima, 1965, Gallimard 1996). Son fils au centre de sa vie – « Un père de handicapé ne se situe pas au centre ! Mais aux côtés des handicapés » – est désormais au cœur de son œuvre « transformant radicalement » sa littérature. Pour la première fois, Ôé écrit un récit très intimiste, en grande partie autobiographique (Une affaire personnelle, Stock, 1994). C’est donc en se tenant à plus d’un titre « légèrement en bordure de ce monde », que l’écrivain va revenir au cœur des choses ; particulièrement là où le pouvoir, à l’aune d’une société chloroformée par un consumérisme égotique, tire le pays vers une dérive nationaliste.

Dans ses Notes d’Okinawa, 1970 (non encore traduites en français), l’écrivain rappelait comment, au printemps 1945 lors de la terrible bataille d’Okinawa, l’Armée impériale força la population à se suicider plutôt qu’à se rendre. Sur les 200 000 morts japonais, la moitié était des civils. Assigné en diffamation par un ancien responsable de l’Armée impériale, appuyé par le premier ministre Shinzo Abe (via son ministère de l’éducation nationale qui avait aussitôt ordonné la suppression des manuels scolaires de toutes références au rôle de l’armé dans ces suicides collectifs) l’écrivain obtenait finalement gain de cause en 2008.Moi d’un Japon ambigu, (Gallimard, 2001) soulignait Ôé dans son discours d’introduction à l’occasion de la remise du prix Nobel de littérature qui couronnait son œuvre en 1994. Il faisait écho vingt-six ans plus tard, au premier écrivain japonais nobélisé. Kawabata Yasunari avait intitulé le sien : Moi d’un beau Japon. « Vivant dans un tel présent, et doté d’un souvenir amer ainsi gravé dans le passé, je ne peux pas unir ma voix à celle de Kawabata pour revendiquer ce Moi, d’un beau Japon. » expliquait Ôé.
Quinze ans plus tard, il ne le peut pas davantage, luttant toujours « contre ce qui nous semble moralement inadmissible et propice à développer un état d’esprit propre à nous rendre capable de faire la guerre ». Ôé se battait alors pour que l’article 9 de la Loi fondamentale de la Constitution japonaise (il interdit au Japon de se réarmer) ne soit pas aboli par le gouvernement. Après la mort de deux otages assassinés par l’État islamique (31 janvier 2015), le gouvernement de Shinzo Abe entend bien réviser sa Constitution.Mais si cet état d’esprit demeure, n’est-ce pas en raison de cette responsabilité que « nous, Japonais, n’avons jamais acceptée ? … Nous devrions réactiver la réflexion nous permettant d’assumer notre responsabilité d’agresseur » rappelait Ôé lors de sa visite en Chine destinée à commémorer le 70e anniversaire du massacre de Nankin (2). En ce premier trimestre 2009 Ôé recevait le prix littéraire du meilleur roman étranger en Chine. C’était, dit-on en coulisse, le premier Japonais que la Chine honorait ainsi.
Philippe Pataud Célérier
(1) www.9-jo.jp/fr/appeal_fr.html
(2) L’armée japonaise entra dans Nankin le 13 décembre 1937 ; elle y massacra durant sept semaines cent mille soldats, quarante mille civils et viola vingt mille femmes.


